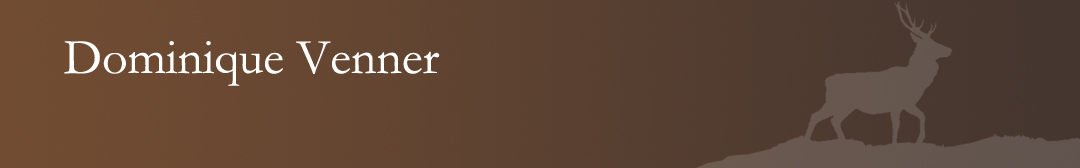En ce début d’année, l’équipe du site vous présente ses meilleurs vœux. Nous sommes au cœur de la saison de chasse. Nous vous proposons cette lecture tirée du « Dictionnaire Amoureux de la Chasse », à savourer sans modération dans les frimas de janvier.
« Vendredi 26 novembre. La pendulette de bord annonce 16 heures. Mon regard las somnole sur un océan de verre et de béton. Nous roulons vers le tunnel de Saint-Cloud. Au vrai, nous ne roulons pas. Dans notre immobilité, nous sentons pourtant la vibration de l’immense pont en spirale qui enjambe la Seine. Notre serpent métallique, cul contre nez, est figé dans l’attente, espérant la décision d’aveugles divinités. Mais le langage qu’entendent les dieux s’est perdu. Puantes et capitonnées, nos boîtes de tôle, stagnent, prisonnières d’un euphémisme appelé « ralentissement ». Au temps de La Bruyère, on disait un embarras. Cela ne concernant que trois carrosses, sentait le cheval ou le crottin.
Englués dans ce rigide ruban, nous progressons par d’imprévisibles saccades, passant nos rages sur les autres victimes. Chaque année, l’agressivité routière tue quelques milliers de bipèdes irascibles. Elle est le dernier exutoire accordé aux mâles en voie de castration. Sur la file de droite, un automobiliste aux yeux vides tressaille au rythme de sons inaudibles. Dans mon rétroviseur, se dessinent les contours imprécis d’un conducteur au sexe non identifié. Prenant appui sur mon volant, j’ouvre un recueil de nouvelles de Giono. Je suis un lecteur d’embouteillages. Dans la ville, cette habitude me vaut les invectives furieuses des impatients. Je savoure des lignes qu’on dirait écrites pour me laver de cet instant même :
« Il n’y aura de bonheur pour vous que le jour où les grands arbres crèveront les rues, où le poids des lianes fera crouler l’obélisque et courbera la Tour Eiffel ; où devant les guichets du Louvre on n’entendra plus que le léger bruit des cosses mûres et des graines sauvages qui tombent ; le jour où des cavernes du métro, des sangliers éblouis sortiront en tremblant de la queue… »
Cela viendra. Malgré mon attachement à cette ville unique, le rêve d’une nature qui se venge est doux à l’imagination. Il chemine et prolifère. John Boorman en avait fait le thème de La Forêt d’Émeraude. A la fin du film, attirées par le chant des grenouilles, des pluies diluviennes font sauter un barrage géant, sauvant la grande forêt amazonienne et les Indiens.
Un furieux coup d’avertisseur me ramène sur la « bretelle » autoroutière pour un saut de lapin. Le temps s’est mis au froid. En avance sur la saison. Beau ciel d’hiver, voilé d’une brume légère que le vent effiloche. Comment le ciel peut-il sembler aussi transparent malgré la calotte grise coiffant la ville ?
A travers le pare-brise, je lève les yeux. Stupéfaction ! Ce que je vois me fait courir le bonheur dans le sang.
Ils sont deux, très haut, par le travers. Deux oiseaux sauvages. Des colverts, si je ne me trompe. Fendant l’air vif au-dessus de nous, ils suivent le cours du fleuve. Fines silhouettes profilées pour naviguer au loin, reconnaissables entre toutes. L’éperon rectiligne du col et du bec s’allonge en avant du mouvement souple des ailes. Que font ces oiseaux en ces lieux, survolant d’hostiles cheminées d’usines ?
Un grand élan de sympathie me porte vers eux. La seule vue de leurs formes insoumises m’arrache à ma servitude.
Indifférents à la grisaille d’en bas, les deux libres voyageurs s’éloignent en direction de l’ouest, loin de nos impatiences et de nos vanités.
Espérant mes sentiments partagés, je cherche autour de moi un signe de connivence. Mais je ne vois que visage sombres et renfrognés, vissés sur cette route immobile. Là-haut, dans l’élégant balancement des ailes, le petit couple sauvage disparait vers le soleil couchant. Oubliant le boa de ferraille dans lequel ma carcasse est enfermée, je remercie le sort de m’avoir donné l’œil complice du chasseur. Malgré ce qui m’enchaîne au sol, je suis du monde de ces oiseaux sauvages, j’appartiens à leur liberté. Et cela, personne ne pourra me l’enlever ».