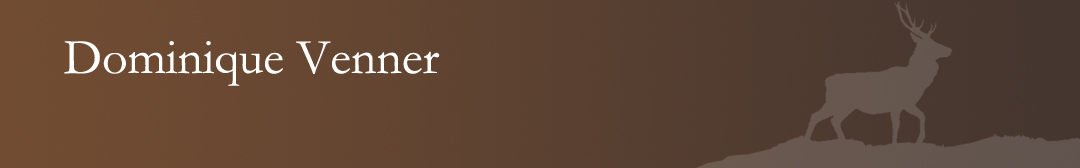Me revient ce matin le souvenir du Noël 1956 en pleine guerre d’Algérie. J’avais été démobilisé en octobre, mais je ne cessai de penser à mes camarades et aux hommes de ma section, à la frontière tunisienne. L’engagement politique intense dans le quel je m’étais lancé tenait pour une bonne part à ce souvenir encore brûlant. J’avais prévu de retrouver ma section dans son cantonnement d’Aïn Zana pour passer avec mes hommes la veillée de Noël. Je voulais également mettre à profit ce bref séjour en Algérie pour poser les bases d’une action future et visitant les quelques personnes qui s’étaient fait connaître au « mouvement ». Je commençais par Oran, Tiaret, Alger, et Souk-Ahras où me reçurent le Dr Thouvenot et son épouse. Brève idylle durant le vol Paris-Oran, comme on peut en avoir dans un avion, à vingt ans, avec une fille du même âge, partageant les mêmes sentiments. C’était une jeune Française du Maroc, agréable et douce. Il n’était pas nécessaire de lui expliquer longuement les raisons de mon combat. Cela contribuait à nous rapprocher. Nous nous savions promis l’un et l’autre à des temps difficiles. Quelques jours plus tard, après des contacts dans l’Oranais et l’Algérois, j’arrivais à Souk-Ahras, petite ville de l’est-Constantinois, devenue une base militaire, que j’avais tant de fois traversée au départ et au retour d’opérations depuis novembre 1954. A mon hôtel, je retrouvais des officiers du 2e REP croisés quelques mois plus tôt dans les djébels.
Rejoindre Aïn Zana n’était pas facile. Le Dr Thouvenot, dont la cinique chirurgicale était transformée en annexe d’un hôpital militaire de l’avant, avait les meilleurs contacts avec nombre d’officiers. Aucun convoi militaire n’était prévu pour ce poste perdu face à « désert des Tartares » qui n’était pas peuplé que de songes. Malgré l’avis très réprobateur de l’excellent chirurgien qui me voyait déjà la gorge ornée du célèbre « sourire kabyle », je décidais d’emprunter un camion de bois qui montait justement vers le cantonnement de mon ancienne compagnie, à travers quelques dizaines de kilomètres de territoire fellouze, autrement appelé zone interdite. Je misais sur mon étoile et, très accessoirement, sur mon pistolet. Il ne m’aurait pas protégé contre un coup de main des HLL ou une trahison de mon chauffeur. Mais il me donnait une illusion de sécurité et m’aurait peut-être permis de tuer quelques agresseurs avant d’y passer à mon tour. En me remémorant cela aujourd’hui, je dois convenir que c’était folie pure. Mais, contre toute attente, mon chauffeur musulman ne fit pas d’entourloupe. Après quelques heures de mauvaise piste, il me déposa devant le P.C. de mon ancienne compagnie. L’arrivée d’un martien n’aurait pas provoqué plus de stupeur chez le nouveau capitaine que je n’avais fait qu’entrevoir naguère. Il avait été pourtant été averti de mon arrivée, mais pas dans un tel équipage. Il me passa un « savon » carabiné. Non seulement j’étais maintenant un civil qui n’avait rien à faire en ces lieux, mais j’avais pris des risques qui ne témoignaient pas pour la qualité de mon jugement, ce qui n’était pas complètement faux. Bref, n’ayant pas le moyen de me réexpédier à Souk-Ahras, il m’autorisa comme je le souhaitais à passer la veillée du 24 décembre avec mon ancienne section. Mais dès le lendemain, me dit-il, je serai embarqué sur un convoi de liaison. Cela me convenait.
Mon ancien commandant de compagnie, le capitaine Jaugeon, ancien légionnaire, officier de troupe remarquable et vrai guerrier, avait été muté je ne sais où. Il n’était plus là pour me protéger et me comprendre à sa façon.
L’accueil de mes hommes fut à la hauteur de ce que j’attendais et mieux encore. Quelques semaines plus tôt, faisant jouer la corde sensible, j’avais requis l’aide de mes trois sœurs. Chacune avait expédié à l’un de mes anciens groupes de combat un copieux colis contenant vins, victuailles et cigarettes, toutes choses précieuses et rares, faites pour égayer le bivouac des soldats dans le fin fond du bled. Au début de la veillée, les caporaux organisèrent une petite cérémonie qui devait me valoir quelques ennuis par la suite. A ma grande stupeur, ayant mis la section au garde-à-vous, ils épinglèrent sur mon anorak civil la croix de la Valeur militaire récemment instituée. L’initiative était touchante mais elle fut fort mal appréciée par la hiérarchie. Il est vrai que trois mois plus tôt, le capitaine Jaugeon m’avait proposé pour une citation à l’ordre, transmise avec avis favorable du colonel. Bien des années après, grâce à la complicité inattendue d’un officier, je découvris, en consultant mon dossier de la Sécurité Militaire, que l’initiative fort peu réglementaire de mes hommes, ajoutée à des rapports de police sur mon activisme politique, avait eu des effets pervers. Tout cela est dénué d’importance depuis longtemps. Ne subsiste en moi que la marque d’estime des hommes que j’avais commandés. Subsiste aussi le souvenir d’une veillée dans la nuit froide, sous les armes, aux avant-postes de notre monde menacé, alors que nos coeurs étaient encore gonflés de l’assurance que donne la jeunesse, l’ignorance des vrais périls et de leur perfidie. Peu après mon départ, la position d’Aïn Zana fut violemment attaquée par des katibas venues de Tunisie. Le futur « barrage » (ligne Morice) n’existait pas encore à cette époque. Si l’on conserve un peu d’esprit aventureux, il n’est pas difficile, je suppose, d’interpréter mon équipée, ce qui m’avait poussé à rejoindre pour la nuit de Noël le hommes avec qui j’avais tout partagé peu avant et vers qui m’appelait un sentiment fraternel. Je me répétais le mot un peu facile de Montherlant, « l’ennui naquit un jour de l’uniforme ôté ». Rejoindre la vie civile m’avait été un poids. J’y avais consenti par raison, ayant compris que cette guerre que nous faisions si mal ne se perdrait ou ne se gagnerait pas dans les djebels mais à Paris. C’était là, pensais-je, qu’il fallait agir et se battre. Je n’étais nullement préparé à ce terrain et à ses embuches. Me tenaillait la nostalgie de nos bivouacs sous les étoiles, de nos marches arides dans une montagne que j’aurais voulue nôtre, de nos chasses à la rencontre d’un gibier armé, de notre camaraderie. C’est avec tout cela que j’allais renouer dans cette nuit de Noël, aux frontières de l’espérance.
Dominique Venner