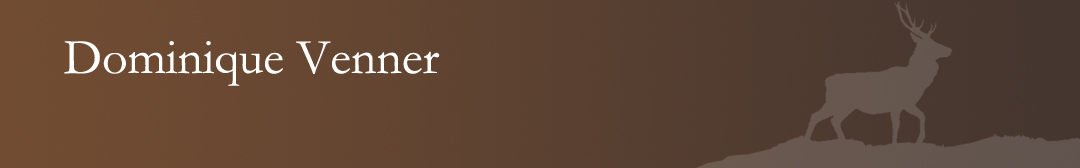Édito de la Nouvelle Revue d’Histoire n°47, mars-avril 2010
Soixante-dix ans nous séparent du printemps 1940, prélude à une effarante déroute. Lâche soulagement pour beaucoup. Honte et révolte pour quelques-uns. Simple désir de revanche parfois, volonté aussi de se relever à coups de trique.
C’est une époque si lointaine de la nôtre par son esprit, que nous ne pouvons plus la comprendre. Et pourtant la nôtre en procède, mais par des cheminements tortueux. Les masses qui s’étaient jetées dans les bras du maréchal Pétain en 1940, auront oublié cet élan unanime quatre ans plus tard. Le vieil homme, jadis couvert de gloire et entouré de ferveur, terminera sa vie dans un cachot humide de l’île d’Yeu, privé par sadisme pur de la moindre vue sur la mer. Que s’était-il passé ? Les événements avaient galopé à l’insu de tous, changeant le blanc en noir et le noir en blanc.
La tâche de l’historien est-elle de se plier aux légendes de couleurs tranchées ? Nous ne le pensons pas. Il nous semble plus stimulant et de meilleure hygiène mentale de tenter de voir la réalité telle qu’elle fût vraiment. Le destin opposé et imprévisible de deux écrivains de 1940 peut nous y aider. Deux écrivains qui n’ont pas ménagé leur engagement, au point de le payer de leur vie.
Commençons par Jean Prévost, écrivain aujourd’hui trop oublié. Après 1940, à la différence de beaucoup, il choisit de se battre avec de vraies armes. En 1943, il rejoindra le maquis du Vercors. Ceux qui servirent sous ses ordres ne le connaissaient que sous le nom de capitaine Goderville, celui du village normand où son père était né. Ce chef sympathique trimbalait dans son sac un manuscrit. Au maquis, il continuait de travailler à un essai sur Baudelaire qu’il ne pourra achever.
Il avait décidé à se battre, mais pour des raisons moins politiques ou patriotiques qu’on ne pense : « Si j’ai choisi d’assumer les risques de l’action, c’est parce que je suis persuadé qu’un homme n’a le droit de vivre, de parler, d’écrire, qu’autant qu’il a connu et accepté un certain nombre de fois dans son existence le danger de mort. (1) »
Pamphlétaire, critique littéraire et romancier, Jean Prévost venait de la gauche pacifiste et plutôt germanophile. C’est le sort injuste imposé à l’Allemagne par les vainqueurs de 1918 qui avait fait de lui, à dix-huit ans, un révolté. Depuis l’École normale, Prévost était proche de Marcel Déat. Il fréquentait Alfred Fabre-Luce, Jean Luchaire, Ramon Fernandez. A la fin des années trente, tous subirent plus ou moins l’attrait du fascisme. Tous allaient rêver d’une réconciliation franco-allemande. Tous devaient s’insurger contre la nouvelle guerre européenne que l’on voyait venir à l’horizon de 1938. Lui-même ne fut pas indifférent à cet « air du temps ». En 1933, tout en critiquant le « caractère déplaisant et brutal » du national-socialisme, il le créditait de certaines vertus : « le goût du dévouement, le sens du sacrifice, l’esprit chevaleresque, le sens de l’amitié, l’enthousiasme… » (2). Une évolution logique pouvait le conduire, après 1940, comme ses amis, à devenir un partisan de l’Europe nouvelle et à tomber dans les illusions de la Collaboration. Mais avec lui, le principe de causalité se trouva infirmé. Il avait choisi de se battre. Pour la beauté du geste peut-être plus que pour d’autres raisons. Il tomba en soldat, au débouché du Vercors, le 1er août 1944.
Dans les engagements, y compris ceux des écrivains, les idées n’expliquent pas tout. Elles comptent même sans doute moins que le tempérament et le hasard. Au cœur du grand séisme des années 40, elles pouvaient conduire aux choix les moins prévisibles. Ses idées et ses amitiés auraient pu faire de Jean Prévost tout aussi bien un partisan de la Collaboration que de Robert Brasillach un résistant.
Normalien comme Jean Prévost, mais de dix ans son cadet, Robert Brasillach était le fils d’un officier tué en 1914. Pour ce jeune Catalan, enfant de la Méditerranée comme son ancien maître Charles Maurras, l’Allemagne n’était pas seulement l’ennemie, elle était un monde totalement étrange et inquiétant.
Tout pouvait l’inciter à suivre ses amis camelots du roi, volontaires des premières troupes héroïques d’une Résistance où l’on se bousculait moins qu’en 1944. C’est pourtant un engagement opposé qui le conduira, au matin glacial du 6 février 1945, à crier une dernière fois « Vive la France » face aux douze fusils français qui allaient le tuer.
Si différents en apparence, Jean Prévost et Robert Brasillach portaient en eux quelque chose qui leur interdisait de s’abstenir. Saluons le courage. Cette denrée se fait rare.
Dominique Venner
Notes
- Jean Prévost, Dix-huitème année, réédition Gallimard, 1994.
- Jean Prévost, Pamphlet, 10 novembre 1933.