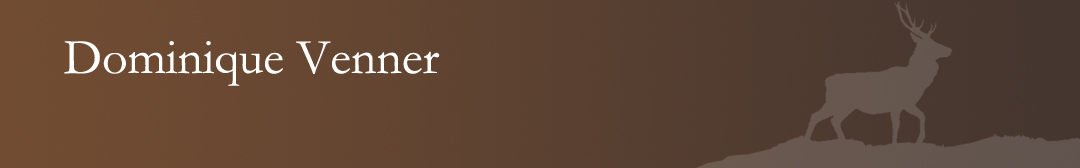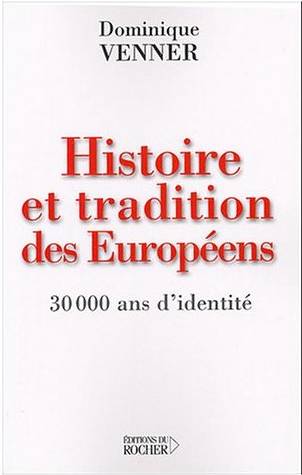Sur le livre de Dominique Venner
Histoire et tradition des Européens
(Essai publié aux Éditions du Rocher en 2002. Nouvelle édition modifiée en 2004. Une troisième édition est en préparation).
L’auteur répond aux questions de la journaliste Laure Destrée.
Question : En publiant Histoire et tradition des Européens, vous vous êtes écarté de vos travaux habituels. Dans ce livre, votre intention avouée est de jeter les bases d’une refondation européenne en partant à la découverte de nos sources. Vous le faites en décrivant l’histoire transnationale des Européens depuis la Préhistoire, en commentant les poèmes homériques qui sont un peu la Bible des Européens, en montrant aussi leurs prolongements dans la philosophie antique. Vous méditez sur Alexandre et l’Orient hellénistique, Rome, sa grandeur et sa décadence, la rupture introduite par Constantin et le christianisme. Vous insistez sur les renaissances ultérieures, celle des Francs et de Charlemagne, celle du Moyen Age celtique, celle, ensuite, du retour aux sources antiques. De page en page, on découvre des perspectives nouvelles, qu’il s’agisse de la féodalité, de l’amour courtois, des principes éducatifs, du rôle des élites, de la forme de l’Etat ou des fonctions multiples de l’Histoire, ce que vous appelez la “métaphysique de l’Histoire”. Pourquoi ce livre ?
Dominique Venner : C’est un livre de fondation. Même si j’avais jusqu’alors assez peu publié sur la longue histoire européenne, le sujet m’était familier. La réflexion historique est toujours présente chez moi, même sur des questions aussi spécialisées que l’histoire des armes. Ce livre est né d’une souffrance surmontée. Celle qu’a provoqué en moi l’effondrement de l’Europe et de ses modèles dans la seconde moitié du Siècle de 1914. Je n’ai pas cessé de méditer sur les causes et les remèdes. De cette méditation est né mon livre. Ce n’est pas un hasard si son élaboration coïncide avec une rupture historique majeure, dont il est en quelque sorte l’écho. Au tournant du nouveau siècle, sans que les contemporains le perçoivent bien, le monde est entré dans une ère nouvelle, résumée par le conflit des civilisations et la faillite du « Progrès », autrement dit de la « modernité ». Celle-ci implose lentement sous nos yeux, malgré les euphorisants de la consommation et des performances techniques. L’époque est à la fois sinistre et passionnante. Contre le flot de la décadence qui détruit tout, on ne peut établir de digue. Je me positionne donc au-delà de ce qui s’effondre, m’efforçant de jeter les bases d’une refondation par un retour à nos sources authentiques. Cette démarche est le contraire de l’ivresse du pire. Il faut toujours se battre. Par principe, et aussi parce que c’est dans la lutte que peuvent se former les acteurs d’une renaissance.
Q. Dès le titre de votre livre, vous invoquez la « tradition européenne », mais dans un sens nullement traditionnel. Qu’est-ce que cela signifie pour vous ?
DV. Mon idée de la tradition est neuve. Elle définit mon interprétation de l’histoire et du destin des Européens. Elle est également applicable aux autres peuples. Elle part du constat que l’histoire conventionnelle de la civilisation européenne est un leurre. Derrière ce leurre se déroule une histoire réelle faite de permanences secrètes. La tradition est l’expression de ces permanences
Q. Comment avez-vous conçu cette idée de la tradition ?
DV. Elle est née d’une souffrance surmontée. Elle n’aurait pu se former avant les épreuves inédites imposées aux Européens au XXe siècle. Elle est née d’une conscience nouvelle de l’identité, que nos prédécesseurs, vivant encore dans un monde relativement ordonné, pouvaient difficilement concevoir. Trompés par le formatage universaliste, nous croyons que tous les hommes sont identiques et nous ressemblent mentalement. C’est l’illusion de la jeune Européenne du roman autobiographique d’Amélie Nothomb, Stupeur et tremblements. Elle aime sincèrement le Japon et voudrait se fondre dans la société japonaise, mais elle découvre douloureusement que c’est impossible. Elle est fondamentalement différente. Toutes ses tentatives pour manifester son initiative et sa générosité sur le mode européen, conduisent à des catastrophes. La leçon implicite est que nous n’existons que par ce qui nous distingue, ce que nous avons de singulier, clan, lignée, histoire, culture, autrement dit notre tradition. Et nous en avons besoin pour vivre autant que d’oxygène.
Q. Quand on pense « tradition » on imagine le temps passé, la nostalgie…
DV. Telle que je l’entends, la tradition n’est pas le passé. C’est même ce qui ne passe pas. Elle nous vient du plus loin, mais elle est toujours actuelle. Elle est notre boussole intérieure, l’étalon des normes qui nous conviennent et qui ont survécu à tout ce qui a été fait pour nous changer. Prenons l’exemple de la place de la femme dans la société et, pour être plus précis, du corps de la femme. Depuis que l’immigration maghrébine nous a confrontés à une autre tradition, nous découvrons que cette visibilité de la femme dans nos sociétés nous est particulière. Elle est rejetée comme un scandale par les mentalités orientales dont l’Islam est la traduction. Mais le plus intéressant est d’observer la constance de cette particularité européenne à travers le temps. Malgré le soupçon séculaire jeté par la Bible et l’Eglise contre la femme, vue comme une tentatrice sexuelle, un être de péché, les Européens n’en ont jamais fait qu’à leur tête. Du nord au sud de l’Europe, la présence sociale de la femme est restée omniprésente durant tout le Moyen Age, pourtant réputé chrétien. Elle est attestée par l’histoire, la littérature et l’iconographie. La nudité antique revient même en force au XVIe siècle, époque pourtant de la Réforme, avec les nombreuses représentations dénudées et cependant pudiques, il faut le souligner, de femmes de haut lignage, dont Diane de Poitiers n’est qu’un exemple. En dépit des semonces de l’Eglise et des menaces de l’Enfer, le respect social de la féminité et la louange de l’amour sensuel ne se sont jamais perdus. Pour preuve, le jaillissement littéraire de l’amour courtois à partir du XIIe siècle. Mais on continue pourtant de parler de « siècles chrétiens » comme si il n’y avait pas une autre réalité derrière cette image simpliste. En fait, l’histoire européenne des comportements pourrait être décrite comme le cours d’une rivière souterraine, invisible et pourtant bien réelle. La rivière souterraine de la tradition.
Q. Comment retrouver notre tradition si elle a été aussi longtemps masquée ?
DV. D’abord par un effort de la pensée, afin de rendre conscient tout ce qui est masqué. Pour reprendre l’exemple précédent de la femme dans la société, les Européens ont toujours nourri une idée réciproque et polarisée du féminin et du masculin, Vénus et Mars, Pénélope et Ulysse, la dame et le chevalier. On se grandit l’un par rapport à l’autre. Cet idéal spontanément vécu ne se trouve ni dans la Bible ni dans le Coran, ni dans le bouddhisme, ni même dans les sagesses asiatiques. Celles-ci honorent la sexualité et le clan familial, ce qu’illustrent fort bien les personnages de la jeune Phuong et de sa sœur dans le roman de Graham Green, Un Américain bien tranquille. Ces cultures, en soi respectables, ignorent le couple comme on l’entend en Europe, formé de deux personnes autonomes, un homme et une femme, s’unissant librement par choix amoureux. En revanche, cet idéal est déjà très présent chez Homère.
Q. Ce que vous dites de la tradition semble donc quelque peu en rupture avec le christianisme. Qu’en est-il exactement ?
DV. À l’origine, le christianisme était une hérésie du judaïsme étrangère à l’Europe, malgré les influences hellénistiques qui s’exerçaient en Palestine, ce qui explique que les Evangiles aient été écrits en grec et pas en araméen. Puis, après une série de hasards historiques, ayant été adopté comme religion obligatoire de l’Empire romain à la fin du IVe siècle, le christianisme s’est glissé dans les vêtements de la romanité, tout en conservant un système sacerdotal hérité de l’Orient, ce qui a donné naissance à la théorie des deux glaives, le spirituel et le temporel. Deux glaives souvent en conflit et pourtant associés. Paradoxalement, l’Eglise s’est muée en légataire de l’Empire romain, ce qui explique sa longue survie. A l’exemple de la Rome impériale et des religions orientales, elle est devenue une institution durable, drainant vers elle des vocations et des ambitions auxquelles elle offrait des justifications temporelles et surnaturelles. Comme ses promesses étaient reportées à un autre monde, elle échappait au péril d’être confrontée à des résultats, ce à quoi n’échappent pas les institutions politiques. Ainsi se trouvait-elle à l’abri des révoltes, hormis celles des hérésies, puis de la Réforme et, un beau jour, de la laïcité, fille de la révolution scientifique qui commence au XVIIe siècle. Au fil du temps, avec un savoir faire remarquable, jouant des convictions sincères et des appétits moins avouables, l’Eglise édifia un imperium qui s’appuyait sur le pouvoir temporel des princes, rois ou empereurs dont elle garantissait la légitimité sacrée, quitte à les combattre quand ils se montraient trop indépendants. C’est là que l’on retrouve les deux glaives qui ont commencé de se séparer définitivement à la fin du XVIIIe siècle.
Q. En se glissant, comme vous le dites, dans les vêtements de la romanité, le christianisme ne s’est-il pas européanisé ?
DV. Les religions sont toujours transformées par les peuples qui les adoptent de gré ou de force. Au Japon, le bouddhisme est devenu guerrier, ce qui était contraire à sa nature. A cours des siècles, le christianisme n’a pas cessé de composer avec les traditions païennes et populaires des Européens, tout en les combattant. Ce qui explique notamment le culte tardif des saints, équivalents des anciens petits dieux païens. A la demande de Jules II, Raphaël a représenté au Vatican les figures de la philosophie antique (L’Ecole d’Athènes) sur les murs de la “Chambres des Signatures”. C’est un symbole des ambigüités d’une religion composite qui pousse à une certaine schizophrénie, une opposition inconsciente entre ses commandements et les comportements. Le christianisme s’est européanisé, mais dans une relation toujours conflictuelle et trouble. Ayant été très longtemps associé à l’Europe, il a été intégré en quelque sorte à sa tradition, sans en être la source, ce qu’a rappelé Benoît XVI lors de son discours de Ratisbonne. Je viens moi-même d’une famille catholique et j’éprouve toujours de l’émotion en contemplant nos anciennes cathédrales ou nos églises de campagne qui, à l’exception de symbolismes hébraïques (les statues des rois de Judée), sont intrinsèquement européennes, ce que l’on ne saurait dire des sinistres édifices contemporains, genre Evry. Le christianisme continue aussi d’apporter des consolations personnelles et un cadre rassurant à ceux qui se réclament de lui par conviction ou habitudes familiales. Pour ma part, je pense que l’on peut se sentir à la fois chrétien et « traditioniste ». Chrétien par attachement à la poésie des rites, des saints et des cathédrales. Traditioniste parce que notre tradition nous relie à nos sources véritables, nous structure intérieurement et fabrique des anticorps contre la décadence. Il faut bien voir en effet que, face aux menaces de notre époque, telles que l’immigration afro-musulmane, une religion culpabilisatrice, universaliste, antiraciste et non-violente, se révèle d’un faible secours.
Q. Pourtant l’Eglise n’était pas non-violente à l’époque des croisades !
DV. Quand elle est en position de force, face à ses propres adversaires, l’Eglise n’hésite jamais devant la violence. Elle s’appuie en ce cas sur le bras vigoureux des Européens, ces « idiots utiles » comme disaient les communistes. On pense bien entendu aux croisades, à la lutte contre les hérésies, mais aussi aux conquêtes coloniales, dont nous payons désormais le terrible prix. Tant que les Européens furent puissants, le christianisme composa avec leur vigueur et en tira profit. Mais depuis que nous sommes entrés en déclin, cette religion nullement identitaire aggrave le mal. La thématique de l’amour universel, l’accueil de « l’Autre », l’idée perverse de la faute et du péché, l’imploration de la pitié divine plutôt que l’exaltation du courage face au destin, le culte de la victime et l’aversion pour la force, tout cela nous mine.
Q. Pourquoi le christianisme n’offrirait-il pas lui-même des anticorps contre la décadence ?
DV. Selon l’opportunité et ses interlocuteurs, l’Eglise tient les langages les plus contradictoires, s’appuyant sur des citations évangéliques qui permettent de dire tout et le contraire de tout. Il n’en reste pas moins que l’imploration de la miséricorde divine (« Seigneur, prends pitié… »), la réprobation de l’amour sensuel, le refus de la contraception, la condamnation de l’orgueil (parce que ce sentiment permet de se passer de Dieu), la prédication larmoyante de l’ « amour » universel, de la « paix » et du pardon (tendre la joue gauche, etc.), sauf pour les hérétiques et les mécréants, tout cela n’est pas sans conséquences. Les effets n’ont pas été directement sensibles pour la puissance européenne quand celle-ci rayonnait sur le monde (ce dont profitait l’Eglise). Il faut cependant bien voir qu’à l’égard des principes de la puissance, de la force et de la vitalité, la position de l’Eglise a toujours été ambiguë. Elle n’aime pas les joies sensuelles de la vie (sauf pour certains de ses princes) ni le goût de la force, associés par elle au mal et au péché. Elle a toujours flatté les pauvres et les faibles d’esprit à qui est promis le royaume des Cieux. Elle use du discours de la compassion, ce qui lui a permis d’attirer les femmes dont pourtant elle se méfie, tant elles ont partie liée avec la Terre et les sens. Durant les longs siècles où l’Eglise exerça sans faiblesse son monopole idéologique, fondement de sa puissance, elle parvint toujours à interdire l’affirmation d’une éthique guerrière et chevaleresque autonome, comparable à celle du bushidô des samouraï. C’est pourquoi il n’y a pas de bushidô européen. Pour trouver l’équivalent, il faut remonter à l’Iliade.
Q. Ne craignez-vous pas de heurter des catholiques par de tels propos ?
DV. Je ne m’adresse pas à des ayatollahs. J’ai de nombreux amis catholiques ou protestants avec qui je parle de ces questions en toute liberté. Ils m’approuvent souvent et ne s’indignent pas. Ils savent que l’Eglise a toujours eu plusieurs visages. Celui de Grégoire le Grand n’est pas celui d’Alexandre Borgia, qui n’est pas non plus celui de Benoît XVI. Et pourtant il s’agit toujours de la même Eglise, vieille institution sacerdotale en partie romaine. Louis XIV, roi très chrétien, peuplait son parc de Versailles de divinité païennes, Mars, Apollon, Diane, Neptune ou Vénus. Il allait écouter la messe chaque matin en sa somptueuse chapelle royale, jouissant des orgues et des chants dans un décor magnifique. Après quoi, il allait forniquer avec ses belles maîtresses et préparer quelques guerres sanglantes pour célébrer sa gloire. Quand je rappelle ces faits à mes amis, ils en conviennent, et ils en rient. Et comme je ne propose pas de fonder une religion concurrente, seulement d’injecter un peu de cohérence dans la conscience de notre identité, ils m’écoutent, sourient et peut-être réfléchissent-ils parfois, devenant un peu plus « traditionnistes ».
Q. Devant la fin d’un monde qui implose, comme vous le dites, sous nos yeux, vous proposez un effort de retour aux sources, donc aux poèmes homériques. Mais comment Homère peut-il parler pour les Européens qui ne sont pas Grecs ?
DV. Homère est l’expression grecque de tout l’héritage indo-européen. La mythologie comparée a montré que son esprit est étroitement apparenté à celui du légendaire celte et gaulois, latin ou germanique. Le personnage d’Achille trouve son double chez le Celte Cuchulain, le Nordique Sigurd et, à vingt siècles de distance, chez le preux Roland, quoique de façon mutilée. La quête initiatique de Lancelot et de Perceval est annoncée par celle d’Ulysse et de Télémaque. Quant aux héroïnes tragiques de Racine, ce sont les modèles antiques qui les ont inspirées (Andromaque, Phèdre ou Iphigénie), prouvant de façon implicite l’existence d’un éternel féminin européen. Et nous-mêmes nous voyons bien que nous sommes en harmonie avec l’esprit d’Homère qui est intemporel.
Q. Pour vous, la tradition semble un invariant. Et pourtant, les changements et les ruptures n’ont pas manqué dans notre histoire depuis Homère ! Aujourd’hui, en Europe, ce que vous entendez par « tradition » paraît complètement oublié.
DV. Elle est surtout ignorée. Pourtant, elle se survit dans notre inconscient. La longue histoire des Européens témoigne d’éclipses et de renaissances constantes sous des apparences nouvelles. Depuis Homère, le goût de l’autonomie personnelle associé à l’esprit de responsabilité, l’amour de la vie et le mépris de la mort, la perception de ce qui est bien par ce qui est beau, la bienveillance sans la sensiblerie, la certitude que la sagesse passe par la connaissance, le sentiment que toute démesure est un danger, ce sont là des particularités qui n’ont pas cessé de distinguer les meilleurs Européens, au même titre que le respect de la femme et que la figure du chevalier, association du courage et la générosité. Achille n’est pas grandi par sa colère, prétexte pourtant de l’Iliade. Il ne devient réellement un preux qu’à la fin du poème, après avoir renoncé à sa folle vengeance, accédant aux prières du vieux Priam et lui restituant le corps de son fils, Hector. Homère nous a légué nos modèles et nos principes de vie : la nature comme socle, l’excellence comme but, la beauté comme horizon, dans le respect mutuel du féminin et du masculin. Il nous rappelle que nous ne sommes pas nés d’hier. Il nous restitue les assises de notre identité, l’expression primordiale de notre patrimoine éthique et esthétique, qu’il tenait lui-même en héritage. Et les principes qu’il a fait vivre par ses modèles n’ont pas cessé de renaître jusqu’à nous. Même quand nous ne le savons pas, nous restons les fils et les filles d’Ulysse et de Pénélope, comme d’autres sont les fils d’Abraham ou de Bouddha. Mais on se porte mieux en le sachant, en étant conscients de ce que nous sommes.
Q. D’où vient la permanence de notre tradition ?
DV. Si la tradition traverse le temps c’est qu’elle a certainement pour assise les dispositions héréditaires de peuples frères, mais aussi un héritage spirituel, dont l’origine plonge dans la Préhistoire, au cours de la longue et mystérieuse maturation qui vit émerger les peuples indo-européens. C’est pourquoi j’ai sous-titré mon livre « 30 000 ans d’identité européenne ». Cela fait allusion à l’impressionnante culture des grottes ornées, présente des Pyrénées à l’Oural et nulle part ailleurs dans le monde. Cette culture nous touche par sa perfection esthétique. S’y manifeste déjà l’esprit de notre esprit. Elle suppose une religiosité cosmique, le sens d’une harmonie entre les hommes et la nature, que l’on retrouve dans la mythologie et la philosophie grecques, la statuaire médiévale, le cycle arthurien, la poésie romantique et jusque dans nos aspirations écologiques actuelles.
Q. Dans votre livre, abordez-vous les questions politiques ?
DV. Je l’ai fait ailleurs, notamment dans Le Siècle de 1914. La politique a son rôle. Il peut être décisif, pour le meilleur et pour le pire, nous l’avons bien vu au XXe siècle. Seulement, dans la période que nous vivons, nous n’avons pas affaire à une crise politique, mais à une rupture de civilisation, ce qui requiert d’autres remèdes que ceux du politique.
Q. Pour résumer, que proposez-vous ?
DV. Face à tout ce qui menace notre identité et notre survie en tant qu’Européens, nous ne disposons pas du secours d’une religion identitaire. A cela, nous ne pouvons rien. En revanche, nous possédons une mémoire identitaire. Cela dépend de nous de la retrouver, de la cultiver, d’en faire une métaphysique de la mémoire. En reprenant la fameuse formulation du Manuel d’Epictète, mais dans un esprit différent, qu’est-ce qui dépend de nous ? Changer la société du jour au lendemain ne dépend pas de nous. Mais changer notre vie et lui donner un sens, cela dépend de nous.